Depuis des siècles, les examens nationaux ont joué un rôle essentiel dans le système éducatif. Le passage d’une évaluation exclusivement orale à l’intégration d’épreuves écrites a marqué une transition significative dans l’histoire de l’éducation. Dans cet article, nous explorerons l’histoire fascinante de cette évolution. Nous allons mettre en lumière les motivations derrière ce changement et les défis qu’il a engendrés. De la traditionnelle récitation de passages religieux aux épreuves écrites rigoureuses, nous découvrirons comment ces transformations ont façonné notre conception de l’éducation et de l’évaluation des connaissances.
L’Évolution des Examens Nationaux : Du Verbal à l’Écrit
Depuis le Moyen Âge, l’examen de connaissance le plus couramment utilisé en France était l’examen oral. Il était souvent administré par l’église à l’occasion de la communion. Cette épreuve joua un rôle significatif dans le développement de l’éducation en France. Les candidats étaient évalués exclusivement à l’oral, récitant des passages de la Bible qu’ils avaient préalablement mémorisés. Cependant, au 19ème siècle, cet examen commença à perdre de sa pertinence à mesure que le niveau d’instruction augmentait dans les écoles.

L’évolution se poursuivit au 18ème siècle, avec l’introduction des premières épreuves orales au concours de l’École Polytechnique. Les examinateurs parcouraient le pays pour évaluer les candidats, souvent en public. Ce prestigieux concours visait à sélectionner les meilleurs esprits. Afin de d’occuper des postes stratégiques en tant qu’ingénieurs, scientifiques, militaires ou explorateurs. Les épreuves écrites ne furent introduites qu’au 19ème siècle.
Le baccalauréat, créé en 1808 pour remplacer les examens ecclésiastiques, consistait initialement en une épreuve orale. Cependant, avec la montée du niveau d’éducation de la population, des réformes graduelles introduisirent des épreuves écrites. L’écriture suscita à l’époque des inquiétudes quant à son impact sur l’intégrité de l’examen. Il était considéré comme authentique seulement à travers une évaluation orale. Néanmoins, l’évolution des mentalités montra que l’écrit permettait un contrôle plus approfondi des connaissances.
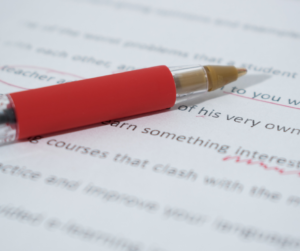
2) Les Défis de l’Organisation et l’Innovation dans l’Évaluation
La croissance continue du nombre de candidats aux examens a engendré des contraintes organisationnelles et budgétaires, ce qui a conduit à l’introduction d’examens écrits. En effet, à partir de 1885, une hiérarchisation des diplômes est mise en place, exigeant par exemple un baccalauréat scientifique pour se présenter au concours de l’École Polytechnique.
Au 20ème siècle, l’évolution de l’importance de l’écrit dans les évaluations a suscité de nouveaux défis organisationnels pour les institutions. En effet, l’intégrité des examens est devenue essentielle pour préserver leur légitimité. C’est pourquoi, les épreuves pertinentes, les examinateurs qualifiés et l’honnêteté des candidats sont devenus les fondements de l’évolution des examens.
Ces principes ont façonné les examens modernes, avec des aspects tels que la surveillance des épreuves, l’anonymat des candidats, la confidentialité des sujets et l’uniformisation des critères de notation.
3) La nouvelle ère des examens : défis et perspectives
Cependant, l’augmentation constante du nombre de candidats a également posé des défis organisationnels et budgétaires liés aux épreuves écrites. En 1969, le ministère de l’Éducation a initié un processus d’archivage des copies d’examens, qui a rapidement rencontré des problèmes de collecte et de conservation. Cette situation a conduit à un échantillonnage des copies archivées en raison des limitations de stockage.
Cette solution, bien que toujours en vigueur, ne garantit pas la représentativité des copies. Aujourd’hui, le baccalauréat produit plus de six millions de copies chaque année, tandis que seulement cinq cent mille copies sont conservées par université.
En conclusion, les examens ont façonné l’éducation depuis des siècles, influençant le parcours des individus en France, de la première épreuve jusqu’aux concours d’entrée dans les grandes écoles. Ils ont soulevé des défis complexes dans divers domaines et ont évolué en réponse aux exigences sociétales, technologiques et organisationnelles. Les examens ne sont pas seulement des instruments d’évaluation, mais des institutions sociales intégrées à notre culture collective.

